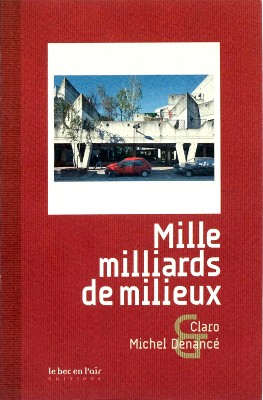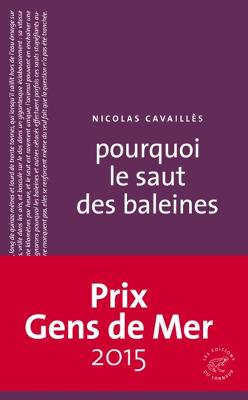Cette chronique est rédigée en partenariat avec la voie des Indés de Libfly et les éditions le Bec en l’air, que j’ai découvertes avec plaisir à cette occasion. N’hésitez pas à parcourir leur catalogue ainsi que les chroniques des lecteurs de Libfly !

« Entre.
Entre ici
Entre ici et là-bas, trente-trois mille pieds. »
Quelque part dans le ciel, un avion explose. Dans un hôpital, une hôtesse de l’air se réveille, seule survivante d’une chute de dix mille mètres. Là, à l’intérieur d’un livre fin et souple, le format à l’italienne dissimulé derrière la couverture surprend. L’on tourne le livre avant de tourner les pages. L’horizontal et le vertical se confondent. On s’immerge, ou plutôt l’on s’extrait. En 90 pages, 23 photos et 10 kilomètres de ciel, on plonge au-dessus du sol, hors de soi, dans l’absence du temps, suivant la trajectoire incertaine d’une exploration de l’espace qui se situe entre ciel et terre, et de ces Mille milliards de milieux en suspension.
« comme un vide soudain avide avide avide avide avidavidavidavidavidavidavid »
Silence de l’air. Disparition de l’écho. Entre les lignes, le vide. Le vide qui aspire points et virgules. Les signes s’envolent, ou tombent, on ne sait plus trop. Comme la chute, la voix s’accélère. Les mots fondent et disparaissent, deviennent parfois un un murmure saccadé. Claro interroge et la chute, de jeu littéraire, devient le lieu d’une poursuite entre le texte, l’image, et le silence. Au fil des pages, l’espace entre. La typographie se fait miroir des mots, et l’espace s’invite entre les phrases, entre les paragraphes, le blanc des pages s’étire, comme la pensée qui défile en chute libre, une chute qui « a duré plusieurs années, même si personne ne me croit. Mais ce sont des années-ciel, très différentes des années-lumière et des années-mort, plus proches des années-amour, en fait. »
« Puis plus rien ou presque »
La forme éveille les sens et aiguise l’esprit, elle contient et exacerbe. Claro écrit en un mouvement les sensations, l’amour, les goûts. Entre les mains, le papier ; sous les yeux, la danse des lignes ; sur le bout de la langue, un gâteau imaginaire, suggéré, provoqué par une succession de verbes évocateurs, une typographie qui éclate, fond, ondule, une vague de sensation gustative qui éveille. Ici, quand je lis, je me disperse en Mille milliards de milieux et me perds entre les dits et les mots qui sont consistance et vie, matière autant orale qu’écrite qui virevolte entre les mains de l’écrivain protéiforme. J’admire ce talent de l’écrivain protéiforme qu’est Claro, cette capacité à se glisser totalement dans la peau d’un autre, d’une autre, à le faire parler, à le rendre vivant absolument, au point de prolonger, brouiller, et suspendre ces deux temps que sont l’écriture et la lecture.
« Le temps cale.
J’erre.
Zut. »
Captivante, la lecture nous plonge dans un état hypnagogique. Comme dans un demi-sommeil, tout devient possible, et l’on saute d’une pensée à une autre, funambules sur un trait en pointillés. L’exploration des souvenirs s’enclenche, discontinue. Dans le ciel de Claro, il arrive que l’on croise des gastéropodes, une méduse, un saumon, des pâtisseries turques, les Beatles ou une machine à écrire. Alors, dans cet état presque second, on regarde, on écoute, et on voit : les photographies, les clins d’œil, les liens et les jeux, le glissement vers le petit matin le long des fils tendus entre le ciel slovène et la terre banlieues de Seine-Saint-Denis. « Je suis une hôtesse, l’hôtesse de l’air, du vide, du ciel, et tout le reste, je l’espère, je le crains, n’est que cendres et littérature. » Les cendres s’envolent, la littérature est belle, et pour une heure de lecture comme celle-ci, je voudrais souvent tomber du ciel, moi aussi.
« J’avais l’impression d’être immobile, mais à une vitesse prodigieuse, et quiconque a déjà fait l’amour au point d’oublier la notion de haut et de bas, de soi et de l’autre devrait pouvoir comprendre cela – quand votre corps revient, que votre cœur se calme, vous êtes toute étonnée d’être allongée dans tel sens plutôt que tel autre, vous ne savez plus où sont vos mains et vos pieds tant que vous n’essayer pas de les bouger, votre pouls semble s’être morcelé et réfugié dans la racine de vos cheveux, et seul un pleur d’enfant pourrait briser la porcelaine de ce moment dont vous êtes devenue un des innombrables motifs – mais avant de pleurer, l’enfant reste à naître. »
Hors.
Avant de vous quitter, je voudrais encore vous glisser un dernier mot, à propos de Pourquoi le saut des baleines, de Nicolas Cavaillès, aux éditions du Sonneur, que j’ai lu récemment. Cette lecture m’a, je crois, trop profondément marquée pour que je n’en parle pas ici, d’autant plus qu’elle s’accorde bien avec Mille milliards de milieux. Ici, des « années-ciel », là, des « abssecs », secondes d’absurde ou secondes d’absences. Dans les deux, l’action de la gravité, l’extraction dans les airs.
Pourquoi le saut des baleines nous donne l’impression de lire la description de ce moment entre veille et sommeil, ce moment où tout devient possible, et où les Pourquoi affleurent à la surface comme des bulles. A lire Nicolas Cavaillès, l’on se surprend à vouloir écouter le chant des baleines, on croit presque les entendre lorsque la dernière page refermée, on éteint la lumière et on les imagine en s’endormant. Doucement, alors que les mysticètes s’arrachent avec fureur et fracas hors de l’eau, l’on plonge au fil des pages dans les profondeurs, on glisse dans les abysses qu’ils explorent, les abîmes insondables qui séparent l’état de conscience du rêve et dans lesquels, peut-être, se situe l’essentiel, et la littérature.