Le 4 mars dernier, Eric et moi avons assisté à une discussion autour de l’afro-féminisme et du livre Ne suis-je pas une femme de bell hooks, dont la traduction a paru en septembre 2015, en présence de Raphaële Guitteaud, militante du collectif afro-féministe rennais Peaux Cibles, et d’Isabelle Cambourakis. Par la richesse des interventions et la volonté de porter la mémoire des luttes, par l’énergie galvanisante et la liberté des paroles exprimées lors de la discussion, cette rencontre, sur laquelle je reviendrai plus longuement dans une chronique du titre de bell hooks, est un beau point de départ pour initier sur le blog une série d’articles consacrés à la collection féministe Sorcières des éditions Cambourakis.

« Nommer sorcière celle qui revendique l’accès aux ressources naturelles, celle dont la survie ne dépend pas d’un mari, d’un père ou d’un frère, celle qui ne se reproduit pas, celle qui soigne, celle qui sait ce que les autres ne savent pas ou encore celle qui s’instruit, pense, vit et agit autrement, c’est vouloir effectivement éliminer les différences, tout signe d’insoumission et tout potentiel de révolte. C’est protéger coûte que coûte les relations patriarcales brutalement établies lors du passage du féodalisme au capitalisme. » Ana Colin, Postface de Sorcières, sages-femmes & infirmières.
« La sorcière est la personnification de la révolte féminine qui, contre le mépris, l’oppression et la persécution, dit oui à elle-même et non au monde tel qu’il est et ne devrait pas être. » Revue Sorcières, n° 1, 1975.
« Se revendiquer sorcière, c’est retourner la menace contre celui qui la formule ; c’est se saisir de son pouvoir et de son savoir ; c’est récupérer son histoire, l’augmenter, la réinventer et la fantasmer si nécessaire, pour mieux se situer, se construire, lutter et imaginer. » Ana Colin, postface de Sorcières, sages-femmes & infirmières.
« Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour. »

Sorcières. [Bûcher, oppression, persécution]. Symbole. Stigmate inversé. Puissance féminine et réappropriation. HistoirE, Herstory : l’histoire des femmes écrites par les femmes. Relis, révise. Tes croyances. Réapprends. Toutes ces femmes levées oubliées effacées. Méconnues. Avant toi, les autres. « Tremate, tremate, le streghe son tornate ! » Histoire des oppressions : histoire des vaincus, question de transmission. « Avec quelle(s) mémoire(s) lutte-t-on ? » interroge Isabelle Cambourakis. Libraire, puis institutrice et syndicaliste, elle s’intéresse aux luttes et aux expérimentations des années 70 : féminisme, écologie, antimilitarisme, anarchisme, mouvements libertaires. Sorcières, collection remarquable, riche d’un déjà très beau catalogue, soignée jusqu’au moindre détail, naît début 2015 de cet engagement dont elle devient suite et partie. L’éditrice, qui rejoint la maison fondée par son frère, publie des textes aux problématiques variées issus de différentes sphères féministes. Des féminismes qu’on connaît mal, ou pas. Des textes différents, singuliers, ancrés dans la vie de leurs autrices, à la conjoncture de l’essai, de la biographie, du témoignage. Des écrits accessibles, loin des réseaux universitaires et de la pure théorie.
Au catalogue figurent surtout des autrices américaines des années 70 et 80 qui n’avaient encore jamais été traduites, ou alors de façon confidentielle, à l’instar de bell hooks qu’Isabelle Cambourakis a découverte par des extraits publiés à l’intérieur de brochures anarchistes. Nombre de pensées développées aux Etats-Unis il y a plus de vingt ans commencent en effet à peine à être abordées en France aujourd’hui. Derrière Sorcières, une idée se dégage : ces réflexions d’ailleurs et d’hier servent et nourrissent les luttes contemporaines d’ici. La collection a pour objectif affirmé cette continuité des luttes, cette volonté de transmission et de rupture du cycle de l’oubli. Le ton est vite donné : une parole libre et accessible, une écriture inclusive (voir ici et là), c’est-à-dire féminisée sans norme et selon la sensibilité des traductrices et des autrices, un accent mis sur la perméabilité des luttes et l’intersectionnalité : écoféminisme de Starhawk, black feminism de bell hooks, jonction de la lutte des classes et du rapport des femmes à leur corps chez Barbara Ehrenreich et Deirdre English, homosexualité avec Dorothy Allison…
Entre parenthèses — L’intersectionnalité est une notion sociologique et une théorie féministe qui prend en compte les interactions des différents types de discriminations comme le genre, la race, la classe, ou le handicap : une femme blanche hétérosexuelle de classe moyenne ne subit pas les mêmes formes de domination et d’oppression qu’une femme racisée ou pauvre ou homosexuelle, etc. Le sexisme, le racisme, toutes les cristallisations de peur et de haine de l’autre, sans hiérarchie, interagissent, se cumulent, se modifient pour former des inégalités multiples et complexes. Cette approche globale et intégrée éclate les cadres étriqués des vieilles théories cloisonnées, pousse à sortir de sa zone de confort et insuffle une énergie exutoire et libératrice à la pensée. A lire, ce long article, mis en ligne par Cairn.info.
La Danse de la sorcière (Hexentanz), Mary Wigman, 1914
Sorcières, sages-femmes & infirmières.
Sorcières, sages-femmes & infirmières, deuxième titre de la collection, est un pamphlet écrit en 1973 par les américaines Barbara Ehrenreich et Deirdre English et d’abord auto-édité sous forme de brochure. Il connaît un succès incroyable dans les réseaux et groupes de paroles féministes et la presse contre-culturelle par le biais duquel il est distribué, au point qu’en 2010 les autrices ressentent l’envie de le publier de nouveau, agrémenté d’une préface qui éclaire et contextualise son écriture. La traduction française compte de surcroît une enrichissante postface d’Ana Colin sur la figure de la sorcière. Barbara Ehrenreich et Deirdre English s’inscrivent la lignée du féminisme matérialiste, courant d’inspiration marxiste pour lequel le système de classes a permis aux hommes de soumettre les femmes et favorise la domination masculine – la lutte contre le patriarcat ne saurait alors se dissocier de la lutte contre le capitalisme. En plein dans la seconde vague du féminisme des années 70, elles placent au centre la relecture de l’Histoire et de l’histoire du féminisme et les rapports de pouvoir sur les corps des femmes : « Notre préoccupation était autant l’égalité de classe et de race que l’égalité entre hommes et femmes. »
Back to the sixties. Aux Etats-Unis, 93 % des médecins sont des hommes, les écoles de médecine ont longtemps été fermées aux femmes, l’interdiction de la pratique féminine de l’obstétrique au début du 20e siècle a provoqué la disparition des sages-femmes. Les femmes manquent cruellement d’informations sur leurs corps – honteuses « parties basses ». Les infirmières, ouvrières du monde médical, sont soumises au diktat masculin des docteurs : « Eliminez le sexisme, et vous éliminez un des piliers de la hiérarchie de la santé. » Révolte et indignation : la résistance s’organise. Contre la dépossession, elle prône la réappropriation des savoirs par les femmes. Le self-help, porté par le livre Our bodies, Ourselves (Notre corps, nous-mêmes) aide les femmes à découvrir leur anatomie, en groupe. Barbara Ehrenreich et Deirdre English ont l’intuition que l’absence des femmes dans la pratique de la médecine n’est pas « naturelle », et se tournent vers deux périodes de l’Histoire : la chasse des sorcières de la Renaissance et la professionnalisation de la médecine moderne aux Etats-Unis au cours du 19e siècle. Malgré quelques « exagérations militantes » avouées et autres erreurs dues au manque de sources, leur texte a contribué à initier les recherches sur la chasse des sorcières, et reste d’une désespérante actualité face à un système médical certes plus ouvert aux femmes mais de plus en plus soumis au profit et à l’économie au détriment des soins et de l’écoute…
« La profession médicale en particulier n’est pas une institution parmi d’autres, qui se trouverait exercer une discrimination à notre encontre : c’est une forteresse érigée pour nous exclure. Cela signifie, de notre point de vue, que le sexisme du système de santé n’est pas accidentel, qu’il n’est pas que le reflet du sexisme de la société dans son ensemble ou du sexisme de certains médecins à titre individuel. Il est historiquement plus ancien que la science médicale elle-même ; il s’agit d’un sexisme profond et institutionnel. »
Postulat. La médecine moderne, masculine et élitiste pose la science en dogme et mystique et sert depuis toujours la classe dirigeante. Elle s’oppose à une médecine empirique, féminine et ancestrale au service du peuple, du voisinage. Histoire. Au fil des siècles, un mythe se créé : la science, religion des hommes, est hors de portée pour les femmes, enclines à la superstition. Aux sorcières puissantes et malveillantes qui forniquent avec le diable succèdent les praticiennes incapables et irresponsables, puis les infirmières maternelles et dociles. Stéréotypes élastiques – condescendance, mépris et répressions fixes. Un écart hors du droit chemin ? Au bûcher ! Au foyer ! A l’usine ! Accès fermé, infantilisation : noyées, la tête dans la cuvette de l’ignorance et de la dépendance. Face à l’erreur, mieux vaut interdire qu’enseigner. En jeu, le monopole politique et économique de la médecine qui a « le pouvoir potentiel de déterminer qui doit vivre et qui doit mourir, qui est fertile et qui est stérile, qui est “fou” et qui est sain d’esprit ». Science critique et critique de la science médicale, de la séparation des fonctions de prescriptions et de soin, du lobbying des médecins contre les pratiques alternatives – qui est proche de l’état pèse sur la loi.

Partie de chasse à la Renaissance, ça commence. Grande peur, folie destructrice et haineuse, la witch craze s’abat sur l’Europe du 14e au 17e siècle. Sont reconnues comme coupables, devant Dieu et les hommes à son image, les femmes cumulant les triples fautes d’être organisées, d’avoir une activité sexuelle et une connaissance gynécologique, d’avoir le pouvoir de faire le mal et de guérir. Ultime péché et grand danger, que la connaissance et l’indépendance vis-à-vis des hommes, des puissants et de l’Eglise. « La vraie question était celle du contrôle : une médecine masculine pour la classe dominante sous les auspices de l’Eglise était acceptable, une médecine féminine intégrée à une sous-culture paysanne ne l’était pas. » L’acharnement pyromane contre le savoir pratique des bonnes femmes et des guérisseuses laisse le champ libre aux médecins issus des universités qui prodiguent un enseignement théorique et théologique, et à la belle et longue époque des humeurs calmées par la saignée et le Pater Noster. Lucratif discrédit.
Quelques siècles plus tard, nouvelle chape de plomb. La professionnalisation de la médecine aux Etats-Unis légifère sur le passage d’une médecine ouverte à tou.te.s les praticien.ne.s (femmes, noir.e.s, immigrant.e.s) à une médecine réservée aux hommes blancs et riches – et dont, de surcroît, les honoraires plus élevés ont le mérite de rendre inaccessibles les soins aux plus pauvres. Bataille législative et lobbying. Un rapport financé par la dynastie Carnegie obtient la fermeture de toutes les écoles de médecines libres qui ne correspondent pas à la nouvelle norme scientifique universitaire européenne. Le hasard faisant bien les choses, ce sont ces mêmes écoles qui ouvraient leur portes aux femmes et aux noir.e.s. Brièvement, un mouvement populaire pour la santé unit en réaction le mouvement féministe et les ouvriers contre une « professionnalisation intrinsèquement sexiste et élitiste » mais, dans la « longue histoire, au XIXe siècle, de la lutte des classes et de la guerre des sexes pour le pouvoir dans tous les domaines de la vie », les combats divergent vite.
Les suffragettes issues de la classe moyenne concentrent leurs efforts sur le droit de vote, et bientôt la projection de leur condition s’étendra hors de la sphère du privé, tendant à s’imposer aux femmes de classes sociales inférieures, véhiculant les idéologies sexistes et bourgeoises à travers des métiers comme celui d’infirmière. « Au docteur, elle apportait la vertu d’obéissance absolue propre aux bonnes épouses. Au patient, elle apportait le dévouement désintéressé d’une mère. Aux employé.e.s subalternes de l’hôpital, elle apportait la discipline ferme mais bienveillante d’une maîtresse de maison habituée à diriger des domestiques. » Des stéréotypes qui ont la peau dure et restent bien ancrés dans notre société qui, malgré les tentatives d’ouvertures, pratique allègrement les distinctions genrées entre les métiers.
Barbara Ehrenreich et Deirdre English soutiennent que « le professionnalisme est – par définition – élitiste et exclusif, sexiste, raciste et classiste », et au regard du monde qui nous entoure, nous ne pouvons malheureusement que leur donner raison. Au-delà de l’ouverture, théoriquement acquise, de tous les métiers aux femmes, il s’agit d’envisager la question sous un angle plus large, de l’inégalité des salaires à l’idée toujours rémanente qu’il ne faut pas paraître trop féminine pour obtenir un poste décisionnaire. Femmes, personnes racisé.e.s, issues de milieux défavorisés, hors normativité : présences en négatif des clichés de société. Soustraction, divisions – le reste est invariable.
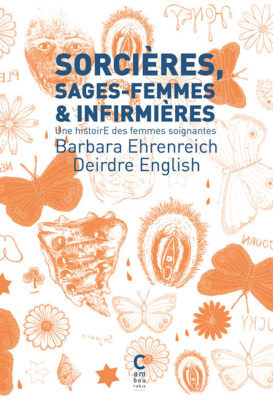
Sorcières, sages-femmes & infirmières, Barbara Ehrenreich et Deirdre English, trad. (anglais) de L. Lame, coll. « Sorcières », éd. Cambourakis, 2014.
La suite ici : Fragiles ou contagieuses, Barbara Ehrenreich et Deirdre English.

