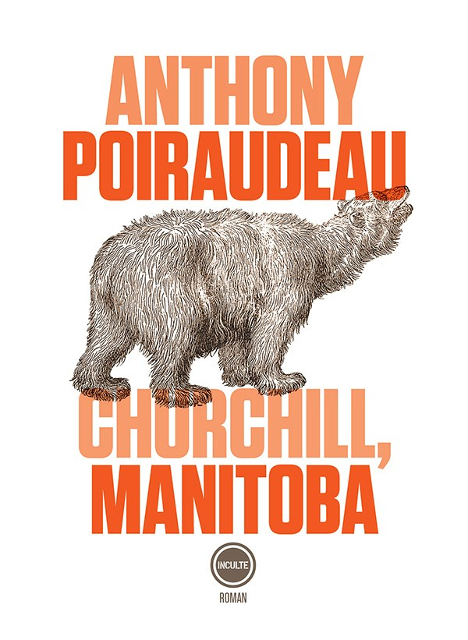« C’est en le retrouvant à loisir là, indiqué sur la planche d’atlas au bord de son rivage perdu, que le petit port de Churchill est progressivement devenu le point de fuite qui a longtemps polarisé ma vie intérieure vers sa plus étrange échappée. »
« J’éprouvais un sentiment que, fort étrangement, je n’avais pas anticipé : je ne voyais plus du tout ce que j’étais venu foutre ici […]. »
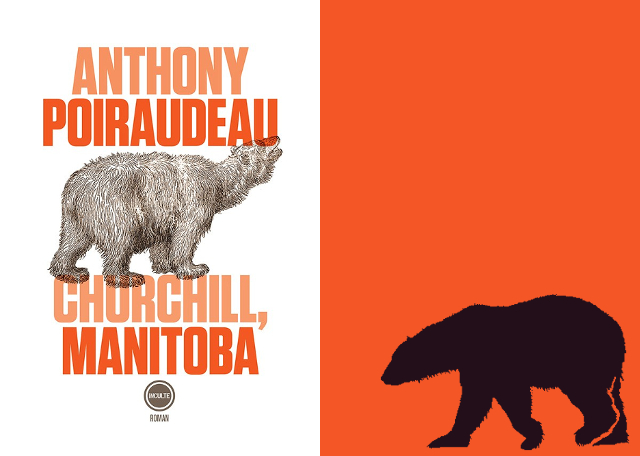
Fasciné depuis l’enfance par les atlas et les globes terrestres, le narrateur hérite à l’occasion du déménagement d’un ami d’une carte Vidal-Lablache de l’Amérique du Nord, et décide de l’afficher au mur lors de ses périodes d’immersion dans la littérature américaine. Objet familier et quotidien, la carte devient peu à peu le réceptacle de « divagations imaginaires et répétées » qui convergent vers un point minuscule situé tout au bord de la baie d’Hudson, loin au-dessus de la Saskatchewan river, du lac Winnipeg et de la plaine céréalière du Manitoba : Fort Churchill.
Nous serons nombreux à nous retrouver dans ces rêveries devant les cartes de géographie, cette fécondation de l’imaginaire par la mappemonde, ce sentiment d’appropriation mentale des lieux repérés sur la carte, cette nécessité de situer — jusqu’à suivre du doigt le parcours des personnages de nos livres. J’ai tracé sur des plans les déplacements d’Arturo Bandini dans Los Angeles et de Mrs Dalloway dans Londres, je connais La Nouvelle-Orléans pour avoir exploré longuement le tracé bleu et vert de ses bayous à la poursuite de Dave Robicheaux. Quant à l’attrait d’un toponyme, combien d’heures ai-je passées les yeux levés vers les îles Nightingale et Inaccessible de l’archipel Tristan da Cunha, dont l’unique ville porte le nom fascinant d’Edimburgh of the Seven Seas ? Ici, cependant, « la superposition de Churchill, en tant que site matériel et réel dont il était possible [au narrateur] d’avoir une connaissance, et de Churchill, en tant que lieu intérieur doté pour [lui] d’une fonction mentale intime » donnent naissance à un voyage réel et à son récit : soudain, l’arrivée à Churchill, Manitoba et le projet d’écrire un livre sur la ville.
Churchill, Manitoba n’appartient pas tout à fait à ces livres précieux sur l’imaginaire des lieux : il s’agirait plus exactement du récit de la réalisation d’un lieu, la coloration d’une zone blanche de la carte — soudain emplie de la sensation du vent dans les roseaux, du cri des oiseaux limicoles, du bruit du ressac, des ondulations d’un rivage gris et vert. Quel écart avec la topographie rêvée lors des songeries passées, quelles étaient les lignes imaginées ? Et maintenant que le point est atteint, qu’y allons-nous faire ? — Il y a bien sûr dans l’idée de Churchill quelque chose de « l’Amirauté sur la mer des Syrtes » auquel il est fait allusion, le narrateur devant d’ailleurs entamer son séjour par la rédaction d’un article sur Julien Gracq, et l’on connaît l’importance de l’auteur dans le rapport d’Anthony Poiraudeau à la littérature. (Lire, à ce sujet, l’article de son blog : voir Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil.)
Pour atteindre aujourd’hui ce petit port d’à peine 900 âmes et de 500 mètres de long autodésigné capitale mondiale de l’Ours polaire, aucune route, mais une voie ferrée qui traverse champs puis forêt pour s’achever au pied d’un silo à grains. Improbable successeur de Glenn Gould qui y séjourna quelques jours, le narrateur s’aperçoit bien vite qu’il peut effectuer en à peine plus d’une heure le tour de la ville. Ses velléités de promenades au milieu de l’immensité déserte de la toundra envahie de midges se heurtent comme un running gag à « l’invariable panneau “STOP DON’T WALK IN THIS AREA” et la silhouette d’ours polaire qu’il affiche ». Ignoré de la population locale qui ne s’intéresse pas à l’écrivain voyageur dont il craint de prendre la pose et à défaut de trouver une autre occupation aux longues journées subarctiques, il se réfugie dans la bibliothèque municipale, refuge rassurant de l’universitaire qui se pense déjà condamné à ne pas en sortir.

« Alors, les grands espaces en majesté, une fois rejoints, avaient rappelé que d’avoir été arpentés par des cartographes, traversés par des explorateurs et possédés par des aventuriers, ils s’étaient trouvés couverts de peuples détruits. »
De longues digressions documentées sur l’histoire du lieu et des différents postes de traite construits à son emplacement approximatif par la Compagnie d’aventuriers d’Angleterre destinée à commercer dans la baie d’Hudson ouvrent alors une réflexion sur le paradoxe contenu par la fascination pour ces lieux lointains auréolés d’un esprit d’aventure et d’exotisme par les récits et romans de l’enfance — ou les cartes Vidal-Lablache — et la prise de conscience du théâtre d’horreurs, de pillages, de massacres en lequel l’époque coloniale les a transformés.
Les découvertes successives, dans le cimetière de Churchill, d’une croix de bois commémorant manifestement une « catastrophe collective » sans l’expliciter ni la nommer puis, dans les rayonnages de la bibliothèque, d’un ouvrage universitaire publié à Winnipeg, donnent au récit une portée politique et sociologique avec la description de la déportation subie par les Dénés Sayisi. Ce peuple des Premières Nations, évacué de son territoire en 1956 par le gouvernement canadien dans le but d’être « sédentarisé et assimilé à la civilisation moderne », fut massé dans un bidonville à proximité du cimetière de Churchill (un lieu à la violente charge symbolique) et livré à lui-même sans aucune ressource. Misère, alcoolisme, mort violente, viols déciment la population en quelques décennies ; dans les années 70, les Déné Sayisi survivants retournent sur leur territoire traditionnel ; la tragédie est effacée de la ville. L’horreur de cette déportation, rappelle Anthony Poiraudeau, entre en résonnance avec la violence sociale dont sont toujours victimes les Premières Nations au Canada. (Lire, à ce sujet, Les étoiles s’éteignent à l’aube et surtout Jeu Blanc de Richard Wagamese, aux éditions ZOE.)
« Longtemps, l’atonie probable de ces lieux s’était même très bien accordée avec le puissant attrait qu’ils avaient exercé sur moi. »
Le journal de bord de son mois canadien est ainsi retardé, reporté, par un narrateur qui interroge sans cesse les raisons de sa présence à Churchill dans une forme de mise à nu de son intimité. Au point qu’il en liste les lieux par négation (« Je repérais les bâtiments remarquables des passés que je n’avais pas vécus à Churchill, […] l’espace vide devant le bâtiment postal où je n’avais pas rêvé à d’autres vies possibles loin de Churchill. »), comme pour se dédouaner de la ville maintenant qu’il y séjourne. Au cœur du livre, une réflexion sur « la suggestion des départs sans idée de retour » à l’« incomparable charge imaginaire, symbolique et poétique », que l’on pourrait opposer à l’errance telle que définie par Raymond Depardon comme « quête du lieu acceptable ». Ces deux pans presque contraires du voyage se rejoignent dans le « fantasme » de « s’y trouver entièrement différent » et « acceptable à soi-même ».
Modifié jusqu’à devenir récit de ce qu’il aurait pu être, le récit finalement est celui d’un point de fuite qui s’échappe et où tout se recoupe — l’échec à le définir le constitue. Churchill, inexorablement intérieure, demeure « le nom possible de ce que fut cette singulière excroissance mentale »
« Moi aussi, le voyage que j’aurais voulu faire à Churchill, celui dont je rêvais véritablement, était un voyage sans idée de retour, et c’était celui d’une rupture radicale avec tout le cours précédent de mon existence. C’est-à-dire que c’était un voyage impossible par nature, complètement fantasmatique et fictionnel, qui pouvait donc ne perdurer que comme fantasme et comme fiction personnelle.
[…] À la place de ce voyage impossible, parce que ce que j’ai voulu écrire était l’histoire de l’impossibilité de ce voyage, et parce que c’était l’occasion d’y aller tout de même, j’ai fait un voyage possible, et je me suis vraiment retrouvé à Churchill. »
Anthony Poiraudeau montre beaucoup d’humour, d’autodérision, mais surtout de finesse dans ce livre aux dimensions multiples qui sous les atours d’un récit de voyage — ce qu’il est au demeurant — est aussi l’analyse d’une double impossibilité : celle du voyage comme celle de son récit, qui échappent tous deux aux définitions où serait grande la tentation de les circonscrire. Alors qu’il aurait pu s’en tenir aux drolatiques mésaventures d’un personnage casanier et peu aventurier égaré dans l’immensité déserte de la toundra, ou bien rédiger une somme documentaire sur ce minuscule point de la carte et ses violentes réalités sociales et historiques, il nous offre avec Churchill, Manitoba une touchante et agréable surprise, écrite dans une langue détaillée, précise et intelligemment articulée.