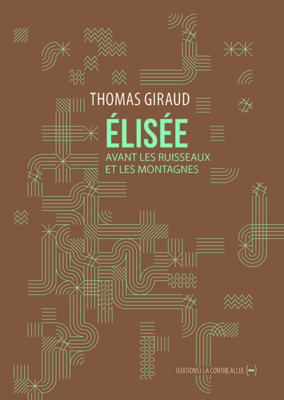« Il lui manque de la lenteur du temps perdu, de l’espace entre les mots. Il commence avec les qualités de la jeunesse, il veut écrire tout le temps, et il veut dire beaucoup, ne rien laisser en chemin, ne rien oublier. Cependant, il lui manque les limites que l’on a comprises en vieillissant, celles qui vous obligent à approfondir ce que l’on sait faire, à contourner les failles personnelles avec des mots légers, à franchir les obstacles en dissimulant la douleur, à mettre parfois du silence pour ne rien dire. Il met des adverbes partout, barbouille d’adjectifs, il est plein d’allégresse et d’envie et il n’a jamais écrit aussi mal. Il écrit, il écrit, il écrit. »
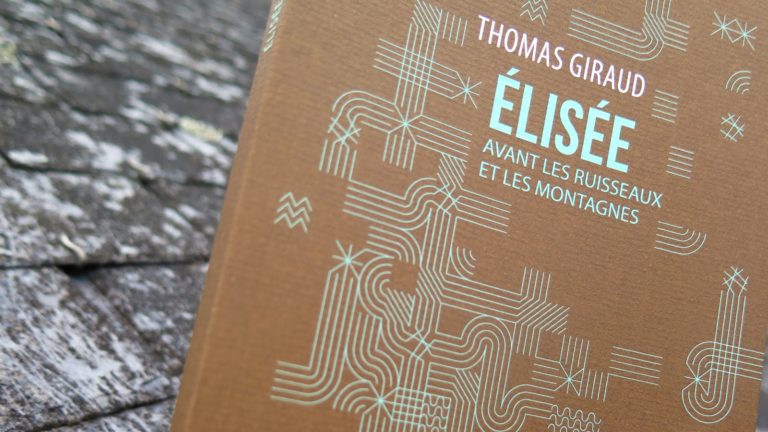
J’ai lu Élisée avant les ruisseaux et les montagnes près d’une fenêtre. Souvent, entre les phrases, j’ai regardé le ciel et, au loin, la campagne. Une heure ou deux, au rythme patient du marcheur ou du lecteur attentif. Sur ce chemin, je me suis attardée pour observer l’arbre, ramasser la pierre, écouter l’eau, humer l’air. J’ai pris le temps de lire Élisée avant les ruisseaux et les montagnes, de le lire doucement, de laisser s’installer ses phrases, sa voix, sa pensée, de m’imprégner de la quiétude et de la sérénité insufflées par ce livre beau et paisible. Il y a de ces écritures qui en une phrase vous saisissent, et d’autres qu’il faut laisser se déployer, qu’il faut peut-être écouter plus que certaines, des écritures qui respirent calmement. Celle de Thomas Giraud s’installe avec retenue, mot après mot, pas après pas. Dans ceux d’Élisée, on progresse doucement. Il faut écouter, prêter attention aux détails, aux motifs, aux répétitions, à leurs variations. — Sur la couverture, des fragments de chemins, le clapot de ruisseaux, des éclis de montagne, les courbes de lignes de dénivelés, traits dispersés d’un vert bleuté. Il y a ces « bouts de pensées » qui rythment le livre, ces pensées à peine formulées, des ébauches qu’Élisée roule sous la langue, tourne dans sa tête, et qui s’allongent, s’élaborent. Ces pensées d’avant l’écriture, qui peuvent accompagner une journée, des prémices, à peine. Des blancs ici les encadrent, et nos yeux s’y reposent, l’on s’y attarde, s’en imprègne, cela touche l’intime et l’on y retrouve forcément aussi un peu de soi.

« Ses pauses lui permettent de s’approprier une multitude d’endroits, quelques minutes, de l’explorer avant de s’allonger pour dormir un peu. On connaît plus précisément la terre sur laquelle on a dormi, ses odeurs, son grain. Ces endroits de sieste lui donnent une connaissance détaillée, en fin de compte, de milliers de lieux-dits, d’arbres égarés, de rus entre deux champs. Il prend de plus en plus de temps. Il en profite pour prendre des notes. »
— « J’aime ces écritures qui avancent, musardent, où tout n’est pas donné, où il faut suivre un chemin en lacet, retrouver la même sensation dite plusieurs fois, mais avec de légères nuances. » Thomas Giraud imagine. Il construit de la fiction dans les blancs, dans les silences que pourtant il ménage. Se permet, parfois, de douter, de supposer. Et pourtant, il affirme, crée des personnages. Il n’agit pas en biographe, mais en écrivain. Élisée avant les ruisseaux et les montagnes, Élisée avant qu’il ne devienne le géographe, anarchiste, végétarien, naturiste que l’on connaît, est la découverte d’un regard et d’une sensibilité qui s’exercent et se posent sur un chemin de retour. Retour double, celui de l’homme mûr qui revient vers les lieux familiaux, et celui de l’adolescent qui emprunte de longs détours pour retourner chez lui annoncer sa résolution de ne pas devenir pasteur. Deux retours, déterminés par un premier aller, une longue diagonale de la Dordogne aux rives du Rhin, un trajet vers la silhouette floue d’Élie, le grand frère, et le collège piétiste de Neuwied. Le livre fait de cette traversée accomplie seul, à douze ans, à pied et en malle-poste, par Élisée, l’instant où « les coutures s’ouvrent » pour l’enfant qui découvre les horizons, les routes, les ciels, les rivières et s’éloigne de son père.
Car il lui faut, pour basculer vers qui il s’apprête à devenir, mettre de la distance entre lui et « Jacques, le père », l’omniprésent, le pasteur « impécunieux », qui dans le roman est l’original, le fou, l’évangéliste qui sermonne, sermonne, à table, au temple, dans la rue, dans la campagne qu’il bat, assomme par un final « vous pourrez beaucoup prier ». « Jacques, le père », un leitmotiv, comme si le géniteur ne pouvait être nommé sans sa fonction. Un père qui s’use les pieds sur les chemins, mais ne s’arrête jamais pour contempler, pour qui le futur des fils aînés est route déjà tracée, vocation, « évidence ». Et puis, il y a Zéline, institutrice privée, et beaucoup de finesse dans ce portrait de mère, que l’on devine intelligente et qui transmet à Élisée « du goût pour l’inconnu qu’on apprivoise en apprenant, pour ce temps intérieur qui fait venir à soi la réflexion ». Zéline, une mère qui, à ce fils qui collectionne des bouts de pensée et de petites pierres, ramassées dans les champs, glissées dans les poches, laissées sur les tables, chuchote. Plus tard, ils s’écriront.
Thomas Giraud retrouve chez Élisée Reclus quelque chose de Giono, une capacité à « parler de la montagne en utilisant le vocabulaire de la mer » et de Rousseau, « celui des Rêveries, le promeneur ». L’on ressent chez lui une certaine fascination pour « le goût d’Élisée pour la multitude et l’éparpillement », pour cette absence de méthode, de hiérarchie, cette façon particulière de saisir dans les paysages autant l’ensemble que les détails, de la pierre aux montagnes, qui fera d’Élisée un homme, un géographe hors du commun. — « Lui ce qu’il aime c’est la nature telle qu’elle se présente et telle qu’elle se modifie, elle-même. La nature comme un œuvre d’art. L’érosion par le vent, par les pluies. Une haie modifiée par la chute d’un arbre. Des racines soulevant la terre. » Au centre, le regard « attentif et direct » d’Élisée, un regard qui « veut embrasser tout, sans réduction », « sans hiérarchie présupposée », un regard qui englobe sans chercher à nommer, celui d’un homme qui respecte la nature et les choses pour ce qu’elles sont, infimes ou immenses. Un regard, et la subtile transcription de ce regard — Élisée avant les ruisseaux et les montagnes, décidément, est un beau livre.
« Pendant les quelques jours du voyage en diligence, il ne pense ni à Jacques, le père, ni à Zéline, ni aux autres frères et sœurs. Mais ce n’est pas de l’ingratitude. Il mange à peine, il découvre et ne peut faire autre chose. Les coutures s’ouvrent, il prend, est avalé en retour dans ce qu’il voit. Même dormir lui est difficile. Il se laisse absorber totalement, prenant les paysages, les rives de la Gironde, celles de la Seine, les contreforts du Bassin parisien, la Champagne pouilleuse, les forêts de l’Argonne, les plaines de l’Est, les boucles de la Meuse, comme une globalité. Il ne hiérarchise pas. Un arbre qu’il ne connaît pas au bord d’un chemin l’émeut autant que les grandes villes. Les pierres, partout, le troublent : les blanches, les ocres, les jaunes, des marbrées, du granit.
Bout de pensée : Tout, tout et donc rien à dire tellement ce tout est immense.
Bout de pensée : Je ne pense plus à mon père. »
Élisée avant les ruisseaux et les montagnes, Thomas Giraud.Collection « La Sentinelle », éditions La Contre-Allée, 2016.
Sur Élisée, lire aussi :
- Sur Remue.net, le journal d’écriture de Thomas Giraud : ELISEE, avant les ruisseaux et les montagnes, un making-of.
- Les écrits d’Élisée Reclus publiés aux éditions Héros-Limite.
- Les chroniques littéraires de Thomas Giraud sur Addict-Culture.

« Les envies de décrire les choses naissent comme elles viennent, aléatoires et imprévisibles, et, par paresse peut-être, mais aussi par respect pour ce qu’elles sont, il lui semble qu’elles peuvent toutes être traitées avec la même énergie et que la connaissance de ces choses-ci et la connaissance née de celles-ci sont tout à fait nécessaires. Et puis, il ne sait pas faire autrement.
Bout de pensée : Je sens l’universel et laisse le général aux autres.
Rien sur le général. On sait, en revanche, que pour lui, l’universel c’est la multitude des détails. »